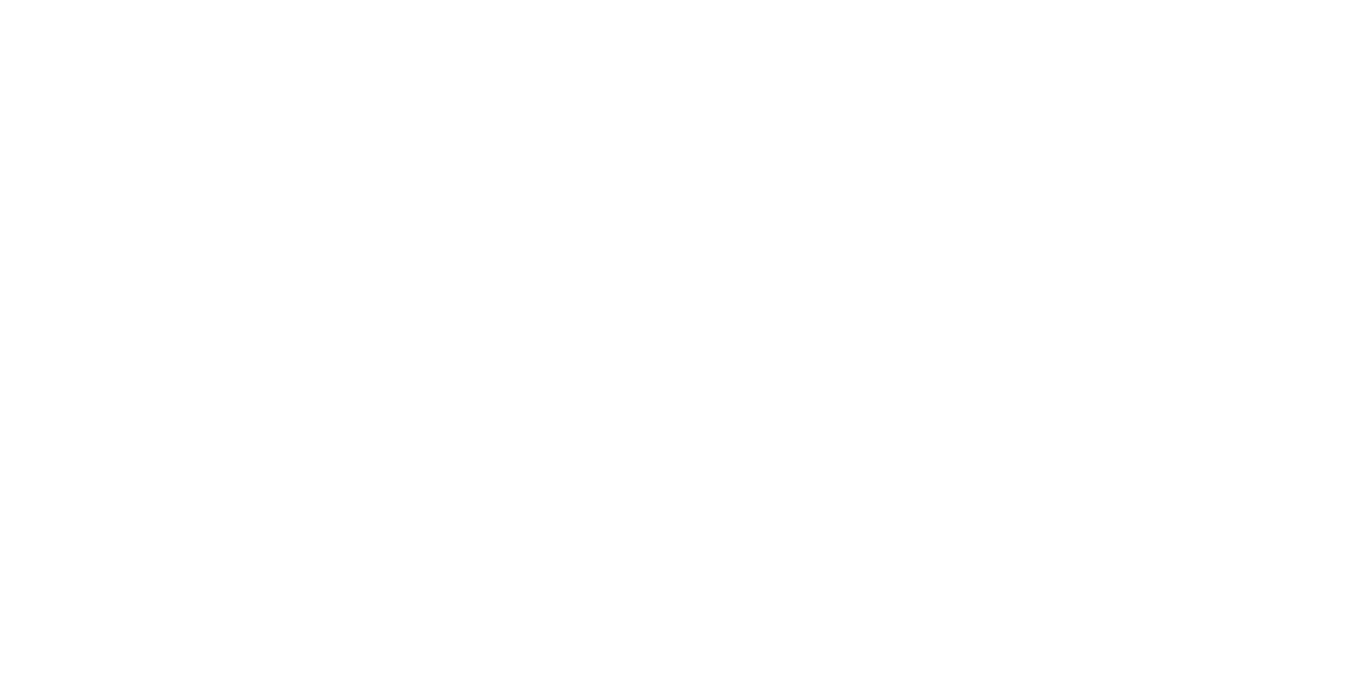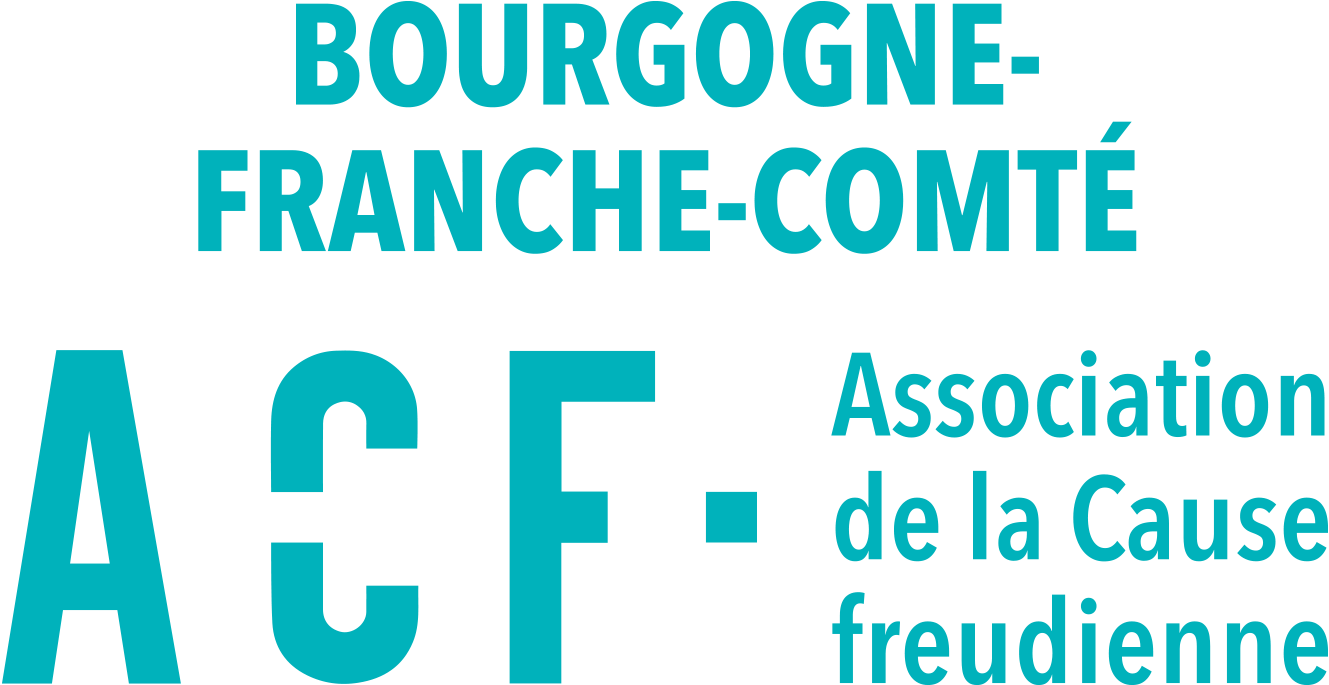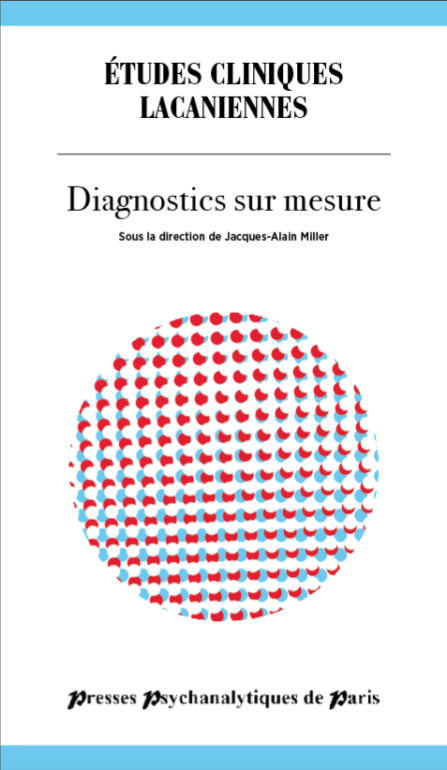Sous la direction de Jacques-Alain Miller
Sommaire :
Avant-propos
Déconstruction d’une psychose / Gil Caroz
Une maladie d’amour / Caroline Nissan
Un cas Caméléon / Laurent Dupont
Pragmatique contemporaine des diagnostics / Jean-Pierre Deffieux
Chacun à sa façon / Ligia Gorini
Une psychose normâle / Agnès Aflalo
AVANT-PROPOS
Carole Dewambrechies-La Sagna
Les psychanalystes porteraient peu d’intérêt au diagnostic. La base de cette affirmation est que le diagnostic est dans son essence médical et que la psychanalyse n’est pas la médecine. Le diagnostic est de l’ordre du discours du maître qui classe, ordonne et juge, alors que la psychanalyse ressortit au discours de l’analyste qui met en jeu le désir, l’objet a et la jouissance, soit ce qui échappe à la détermination. Ce volume démontre que le discours analytique peut s’adosser au discours du maître pour le subvertir, le décompléter, mais il lui donne sa place.
Le plaisir « à faire de la nosographie », « le bonheur intellectuel » de nommer, propre au XIXe siècle, que Freud reconnaît comme étant à l’œuvre chez un Charcot, a diffusé hors de son champ d’origine pour concerner le grand public. La plupart des patients ne se présentent-ils pas avec un autodiagnostic trouvé sur Internet ? Une jeune fille me disait ainsi récemment : « J’ai des pensées intrusives. J’ai contrôlé sur les réseaux, il y a des groupes qui parlent de cela. C’est ce qui me fait souffrir. Sans cela je serais heureuse. Enfin, pas vraiment, car je vois toujours les choses de façon négative, mais c’est peut-être parce que je suis HPI. Cela entraîne des difficultés avec les autres. » Ce ne sont donc pas les diagnostics qui manquent.
On voit dans cet exemple que la nosographie psychiatrique est intimement liée à la société qui la promeut et qu’elle évolue avec elle, comme la théorie qui la sous-tend. Sa diffusion est contemporaine de l’évaporation de la psychiatrie classique. Ce qui est diffusé est plus de l’ordre du prêt-à-porter que du « sur-mesure » prôné par la psychanalyse, terme que je reprends de Jacques-Alain Miller.
Freud posait que la psychiatrie décrit des symptômes, alors que la psychanalyse a pour objet leur mode de formation. C’est ainsi qu’il a commencé son travail – comme il le souligne – par une innovation nosographique, la toute nouvelle névrose obsessionnelle, mais aussi par la mise en place de la bipartition névrose / psychose, dont Lacan situera les fondements dans le Nom-du-Père.
Paradoxalement, donc, c’est bien la psychanalyse qui se trouve être le refuge de la clinique et cette clinique inclut l’histoire de la psychiatrie et ses nosographies.
Pensons à Clérambault – « notre seul maître en psychiatrie 1 », disait Lacan – qui avait hissé le diagnostic au rang d’art, tout en préservant sa part d’énigme.
À cet égard, le jeune Lacan reprend la leçon de Clérambault dans ses Premiers écrits 2 : dans chaque cas – J.-A. Miller le souligne dans la préface à ce précieux volume –, Lacan cherche ce qui contredit la théorie et oblige à repenser les catégories. Il a lu Freud et a retenu le conseil d’aborder chaque cas comme s’il était le premier. La psychanalyse privilégie le nouveau.
Mais la psychanalyse, c’est la découverte de l’inconscient qui éclaire un autre aspect que la psychiatrie classique obturait : le transfert. La clinique psychanalytique inclut le transfert. C’est une clinique sous transfert 3, comme l’a souligné J.-A. Miller.
Les cas cliniques présentés dans ce volume démontrent la prise de l’analyste dans le symptôme. C’est ce qui permet qu’à la singularité la plus marquée réponde un diagnostic sur mesure, qui fait écho à cette singularité déployée par le discours d’un sujet, au fil des années.
Le diagnostic peut être implicite ou non, précis ou flou, variable dans le temps, mais il recèle, dans les meilleurs cas, une surprise. Lacan n’a-t-il pas évoqué Kraepelin et la « paraphrénie imaginative » dans la discussion qui a suivi une présentation clinique de Sainte-Anne 4 ?
- Lacan J., « De nos antécédents », Écrits, Paris, Seuil, 1966, p. 65.
- Lacan J., Premiers écrits, Paris, Seuil / Le Champ freudien, 2023, p. 47.
- Cf. Miller J.-A., « C.S.T. », in Miller J.-A. (s/dir.), La Conversation clinique, Paris, Le Champ freudien éditeur, 2020, p. 23-28.
- Cf. Lacan J.,« Présentation de Mlle Boyer », in Miller J.-A. & Alberti Cs/dir.), Ornicar ? hors-série. Lacan Redivivus, Paris, Navarin, 2021, p. 124.
Prix : 14 euros