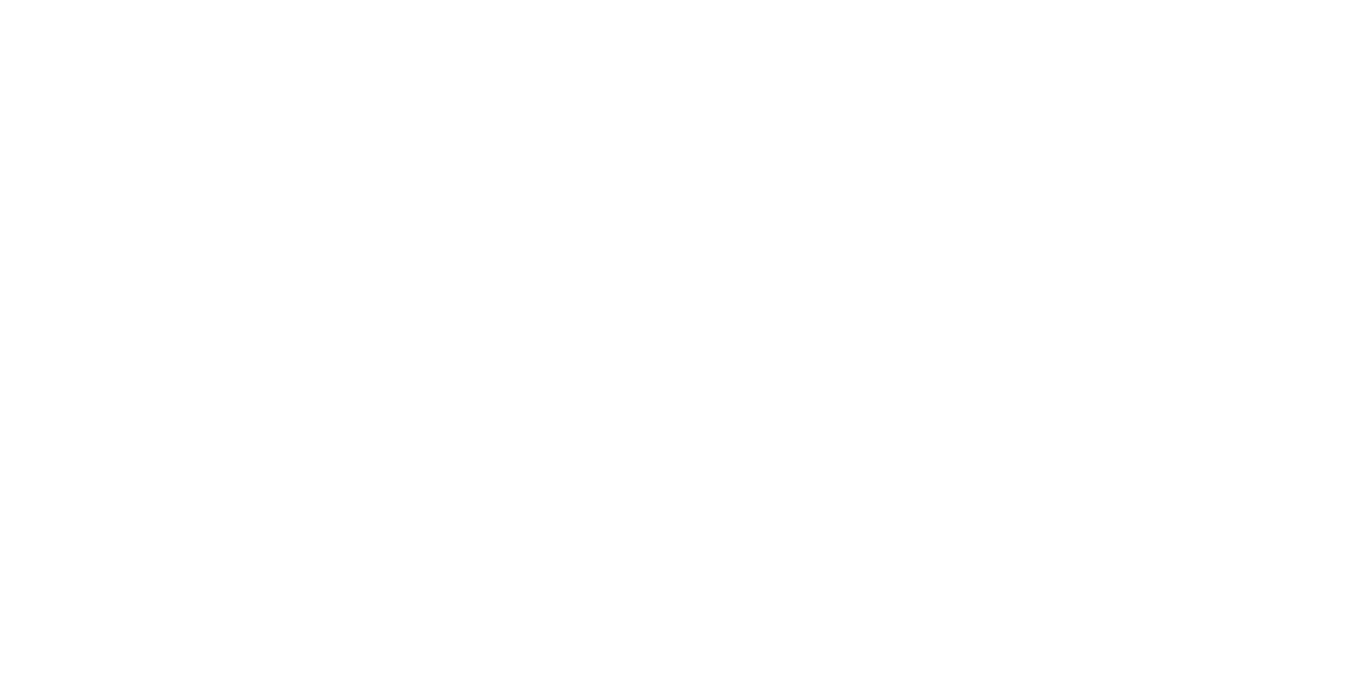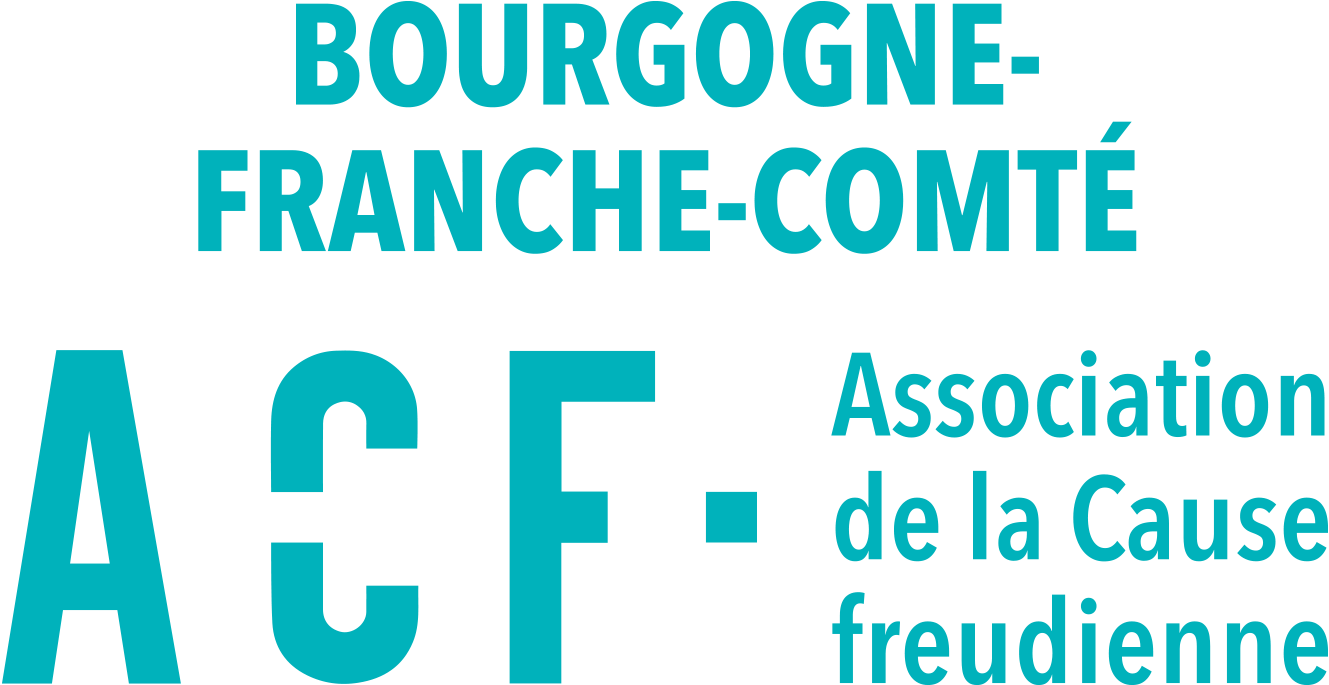Par Sophie Desbois
Je me suis intéressée, dans ce cartel au cas de Pierre Rivière, dont j’avais tenté de cerner la logique lors d’une séance de séminaire l’année dernière. Pour ceux qui ne connaissent pas ce cas, Pierre Rivière est un jeune paysan qui tua en 1815 sa mère, sa sœur et son frère, sur fond de délire paranoïaque : il s’agissait pour lui de sauver son père des griffes de sa mère qui le persécutait.
J’ai pris mon départ du mémoire de Pierre Rivière, un écrit donc, dans lequel il narre sa vie, celle de ses parents, ainsi que les motifs de son crime. C’est en prison qu’il l’écrit, en 11 jours seulement. La première phrase du mémoire : « Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère, et voulant faire connaître quels sont les motifs qui m’ont porté à cette action[1] » m’avait d’emblée intriguée par sa formulation claire, précise et décidée, tant elle contraste avec l’absence de position d’énonciation dans la suite du texte (qui est une succession de descriptions factuelles sur un mode métonymique), d’implication subjective. Pierre Rivière n’a pas écrit son mémoire à sa propre initiative. C’est le juge qui lui demande d’écrire sur son histoire et son crime.
Au XIXè siècle, c’est la dimension de l’aveu qui est en jeu, non au titre de preuve, les faits étant établis dans certains cas, comme l’analyse M. Foucault[2], mais d’une part comme reconnaissance du pacte social, engagement punitif, d’autre part comme volonté d’arracher quelque chose d’une vérité au criminel. A l’époque de Pierre Rivière, l’aveu du meurtre ne suffit plus, on veut comprendre ce qui échappe à la compréhension commune. M. Foucault le formule ainsi : « ‘Dis-moi ce que tu as fait, mais dis-moi surtout qui tu es’. L’histoire de Pierre Rivière était, à ce propos, très significative. Nous avons là un crime que personne ne comprend. Et le juge d’instruction, en 1837, a l’idée de dire : ‘Bon il est évident que tu as tué ta mère, ta sœur et ton frère, mais je n’arrive pas à comprendre pourquoi tu les as tués. Ecris-le’ »[3]. C’est la jouissance en jeu chez le criminel que l’on veut arracher dans l’aveu, F. Biagi-Chai utilise cette formule : « crache-moi ton objet a ».
L’historien P. Artières montre qu’au nom de la science, de nombreux écrits de criminels verront le jour dans les décennies suivantes, à l’initiative entre autres du médecin légal, expert auprès des tribunaux, A. Lacassagne qui entreprit la collecte de dizaines de témoignages de détenus, les enjoignant à écrire, de façon dirigée, de gré ou parfois via des manœuvres de séduction ou récompenses[4]. Son but, scientifique, était, de constituer une documentation suffisante permettant de « percer l’opacité de la personnalité criminelle[5] », un profil.
L’injonction de l’Autre à Pierre Rivière, la demande du juge qui s’inscrit dans l’ère du temps, m’a inclinée à relire la phrase inaugurale de son manuscrit comme – c’est une hypothèse – la formulation du juge (« Toi, Pierre Rivière, ayant égorgé ta mère… », peut-être même quasiment in extenso et en miroir) dans sa requête à l’accusé, d’où la rupture du type d’énonciation dans la suite du texte. Cette phrase, mise en exergue dans l’ouvrage et choisie comme titre par M. Foucault, est finalement peut-être celle qui « est le moins » Pierre Rivière.
Il avait pourtant commencé à écrire son mémoire avant le meurtre, même s’il a abandonné ce projet. Toutefois, la prescription du juge change tout, et l’écrit n’a pas alors valeur de solution subjective pour Pierre Rivière comme dans d’autres cas pour lesquels l’écriture en détention fut salvatrice en régulant une jouissance envahissante. Nous pensons au criminel de l’impératrice d’Autriche, dite « Sissi l’impératrice », Luigi Lucheni – dont nous avons eu l’occasion de discuter en cartel -, ouvrier anarchiste paranoïaque qui a écrit ses mémoires en prison pour s’expliquer sur son acte. C’est lorsqu’un gardien lui vole ses écrits que celui-ci s’effondre puis se suicide, privé de ce qui le tenait dans l’existence, témoignant par-là de la fonction du dépôt de la lettre que pouvait constituer pour lui son travail d’écriture. La rédaction du texte de Pierre Rivière, d’être conjoncturelle – Pierre Rivière étant en position d’être objet de l’Autre, Autre judiciaire – est ainsi sans effets.
[1] Foucault M., Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère…, Gallimard, Folio Histoire, 1973.
[2] Foucault M. Mal faire, dire vrai. Fonction de l’aveu en justice, University of Chicago Press, 2012, p. 249.
[3] Ibid.
[4] Artières P. Le livre des vies coupables. Autobiographies de criminels (1896-1909), Albin Michel, 2000, 477 p.
[5] Mucchielli L (dir.). Histoire de la criminologie française, L’Harmattan, 1994, p. 171.