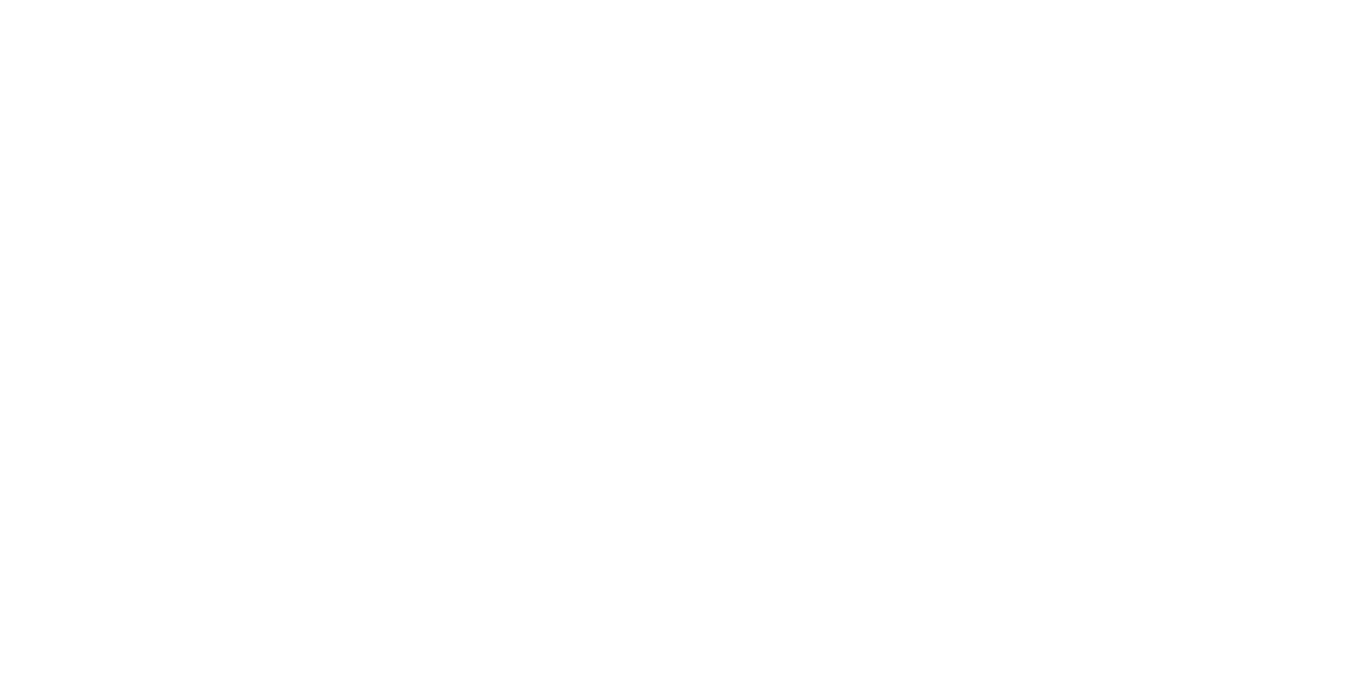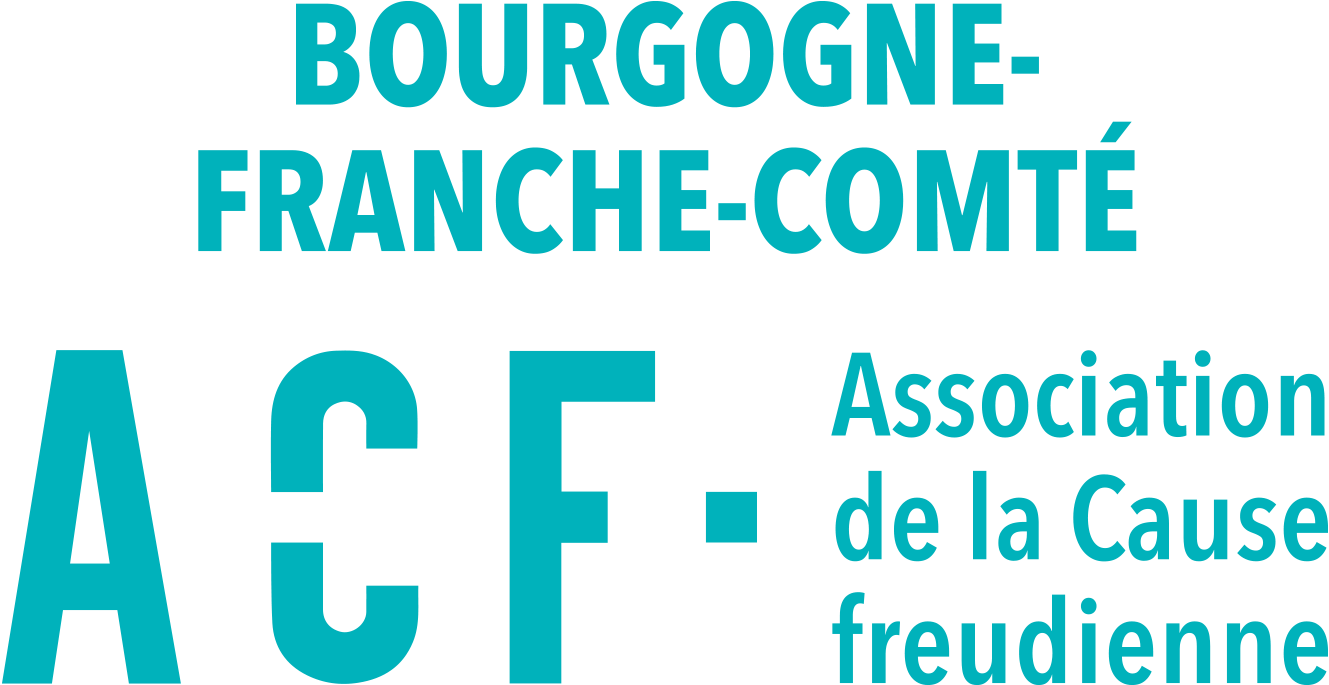Par Marie-Bénédicte Auboussu
Lors de notre cartel, nous avons étudié le texte de Lacan « Introduction théorique aux fonctions de la psychanalyse en criminologie », datant de 1950. Une phrase s’est particulièrement détachée : « si la psychanalyse irréalise le crime, elle ne déshumanise pas le criminel »[1]. Cette phrase a été répétée par Francesca Biagi Chai lors de son cours « Le crime à l’ombre du réel » et lors de notre cartel.
Concernant le crime réel, Lacan évoque le recrutement d’éléments asociaux dans l’armée qui produisent des crimes asociaux mais qui ne sont pas déterminés par des signifiants singuliers. Il parle ainsi des viols dans l’armée comme « goût qui se manifeste dans la collectivité ainsi formée, au jour de gloire qui la met en contact avec ses adversaires civils, pour la situation qui consiste à violer une ou plusieurs femmes en la présence d’un mâle de préférence âgé et préalablement réduit à l’impuissance, sans que rien fasse présumer que les individus qui le réalisent, se distinguent avant comme après comme fils ou comme époux, comme pères ou citoyens, de la moralité normale. […] Nous disons que c’est là un crime réel, encore qu’il soit réalisé précisément dans une forme œdipienne »[2]. Dans le crime réel, le sujet répond aux structures symboliques de la société par des conduites réelles. Dans le crime irréalisé, le sujet répond par des conduites symboliques. Le crime est déterminé par des éléments symboliques singuliers au sujet qui le produit. Alexandre Stevens note que « le crime est irréalisé parce que le réel du crime se réduit à la réalisation des semblants. Il est certes réel dans ses effets, mais son expression se fait sur un mode irréel »[3]. Dès lors, le rôle de la psychanalyse est de s’intéresser aux coordonnées symboliques et à la logique propre du sujet criminel. La psychanalyse déplace la lecture du crime et l’irréalise.
Dans son texte, Lacan qualifie d’ironique la maxime « nul n’est censé ignorer la loi »[4]. En effet, que dire alors du sujet schizophrène définit par Jacques Alain Miller comme « le sujet qui se spécifie de n’être pris dans aucun discours, dans aucun lien social. […] C’est le seul sujet à ne pas se défendre du réel au moyen du symbolique […]. Il ne se défend pas du réel par le langage, parce que pour lui le symbolique est réel »[5]. L’ironie est son arme, elle attaque le lien social en disant que l’Autre n’existe pas, que tout discours est semblant. Francesca Biagi-Chai indique dans son cours que le cynisme est dans l’acte le pendant de l’ironie dans le discours. Dans le discours, il y a une sorte de matérialisme très épuré, une rigueur du signifiant. Cette ironie peut aboutir à un « pragmatisme cynique »[6] dans la réalisation de crime. Ainsi, à propos de Landru, Francesca Biagi-Chai parle d’un « cynisme de structure »[7]. Elle précise qu’il ne s’agit pas d’un sujet cynique qui jouit du cynisme mais que son mode de jouir, la froideur et la rigidité de son programme signifiant nous apparaît à nous comme cynisme.
[1] Lacan J., « « Introduction théorique aux fonctions de la psychanalyse en criminologie », Ecrits, Paris, Seuil, 1966, p. 129.
[2] Lacan J., « « Introduction théorique aux fonctions de la psychanalyse en criminologie », op. cit., p. 131-132.
[3] Stevens A., « Le crime irréalisé ? », Quarto, n°71, décembre 2000, p.115.
[4] Lacan J., « « Introduction théorique aux fonctions de la psychanalyse en criminologie », op. cit., p. 130.
[5] Miller J.-A., « Clinique ironique », ouverture de la Ve Rencontre Internationale du Champ freudien, Buenos Aires, 1988, La Cause freudienne, n°23, 1993, p.5.
[6] Biagi-Chai F., « Haine ou ironie des tueurs en série. Le cas Shipman », in Hamon R. et Trichet Y. (s/dir.), Radicalités contemporaines et crimes de haine, Rennes, PUR, 2023, p. 163.
[7] Biagi-Chai F., « Le crime à l’ombre du réel », Campus ECF 2023-2024, cours du 5 octobre 2023, inédit.