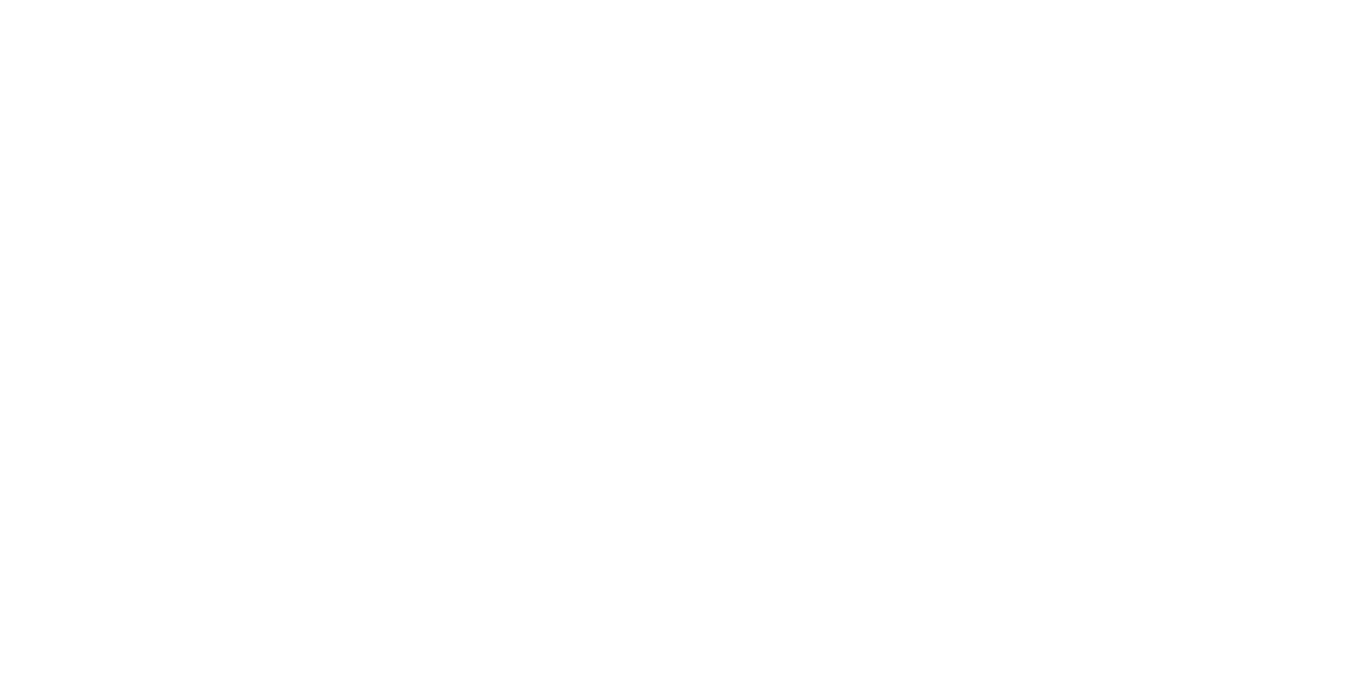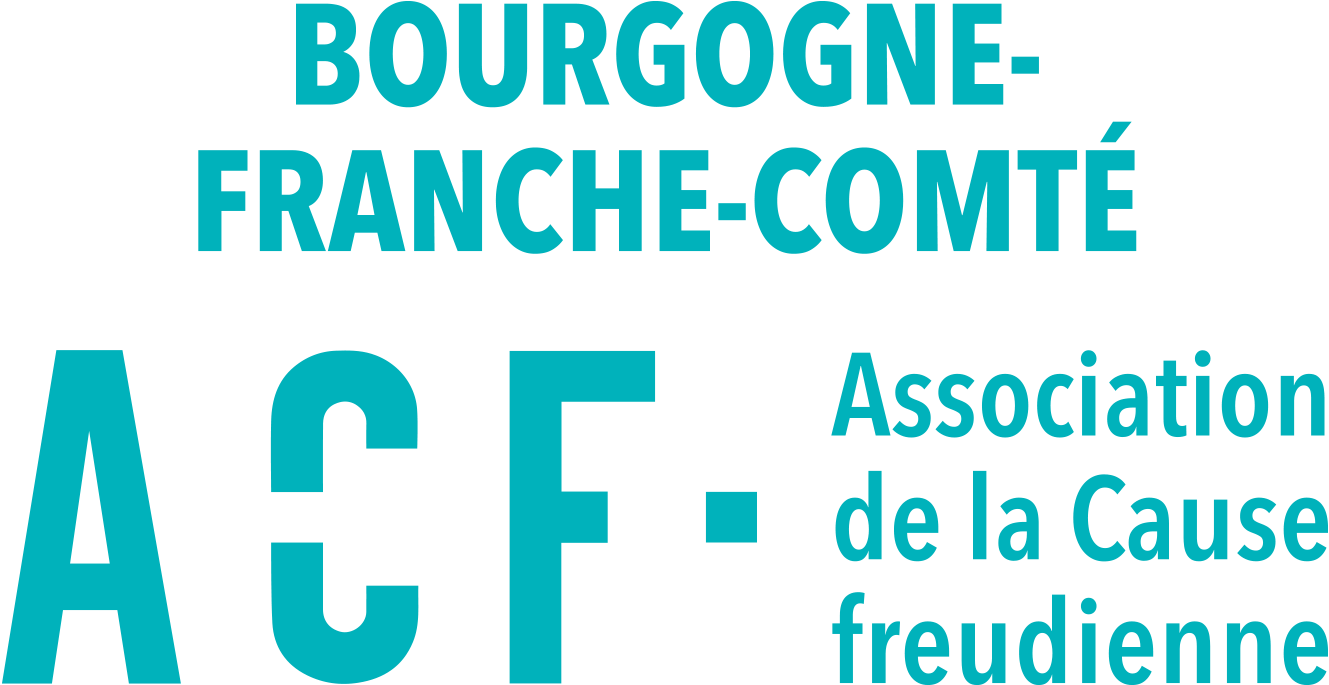Par Didier Mathey
Sören Kierkegaard écrit, dans Le concept d’ironie constamment rapporté à Socrate[1], dans le chapitre III La conception devient nécessaire, que « ce que nous voyons en Socrate, c’est la subjectivité dans l’infinie exaltation de la liberté, et c’est là, précisément, l’ironie »[2]. « Entre ses mains, l’ironie n’est pas un instrument en service de l’idée ; l’ironie est son point de vue : il ne possédait rien de plus.[3] », « L’ironie est le commencement, et pas davantage[4] ».
Socrate, que rien ne préparait à ce qui sera son acte – ce qui peut se discuter à propos de la maïeutique, l’art d’accoucher –, est venu signifier aux sophistes et à Athènes même la vanité de sa position et de la leur par voie de conséquence.
« Les sophistes représentent le savoir multiple et varié »[5], détaché de la vérité. La société grecque, dont Athènes était l’expression la plus éminente, en était arrivé à un point de corruption telle que sa chute était d’une évidence imminente.
Socrate dévoile les semblants. « Ce que [les sophistes] voulaient avant tout, c’était apporter aux hommes une culture générale, plus que des connaissances particulières.[6] »
Socrate œuvre par une négativité infinie par son ironie. Hegel reproche à la position de Socrate de ne recéler aucune positivité. Effectivement, Socrate révèle la dégradation du savoir et du lien social pour le dissoudre, mais pour ouvrir sur un commencement. Hegel reproche à Socrate que les doctrines philosophiques issues de son geste se contredisent entre elles. Cela tient au fait que son geste ironique permet à chacun d’entretenir son propre rapport à une vérité, sans lui prescrire de principe.
C’est ce qu’il y a de commun à Socrate et au psychanalyste. Socrate pointe les limites du discours du maître, sans le dénoncer, et ouvre la possibilité à chacun de se servir de son symptôme dans un rapport vrai avec le réel auquel il a affaire. Il ne prescrit aucun idéal.
« Car l’ironie comme la loi est une exigence, et une exigence énorme, car elle dédaigne la réalité et exige l’idéalité »[7]. L’idéalité n’est pas l’idéal. Elle laisse libre chacun de promouvoir un idéal singulier.
La position de Socrate est différente de celle du schizophrène. En effet, Socrate est pris dans le discours du maître grec, qu’il subvertit par son ironie. Son acte prend son ressort du symbolique. Jacques-Alain Miller dit que le schizophrénie est le seul à ne pas se défendre du réel au moyen du symbolique. Jacques-Alain Miller dit que l’ironie n’est pas de l’Autre, mais du sujet. Kierkegaard ne dit pas d’autre chose : « l’ironie est son point de vue ». Et elle va contre l’Autre. Socrate contre les sophistes et Athènes par son silence ironique, les arrête et les déstabilise. « L’ironie est la forme comique que prend le savoir que l’Autre ne sait pas, c’est-à-dire, [que] comme Autre du savoir, [il] n’est rien »[8]. « L’ironie ne s’exerce que où la déchéance du sujet-supposé-savoir est consommée »[9].
[1] Kierkegaard Sören, « Le concept d’ironie constamment rapporté à Socrate », Œuvres complètes II, éditions de l’Orante, Paris, 1975, pp. 1-297.
[2] Ibidem p. 191.
[3] Ibidem p. 194.
[4] Ibidem p. 194.
[5] Ibidem p. 184.
[6] Ibidem p. 184.
[7] Ibidem p. 194-195.
[8] Miller Jacques-Alain, Clinique Ironique, Revue La Cause freudienne, N° 23, L’énigme et la psychose, février 1993, p. 8.
[9] Ibidem p. 8.