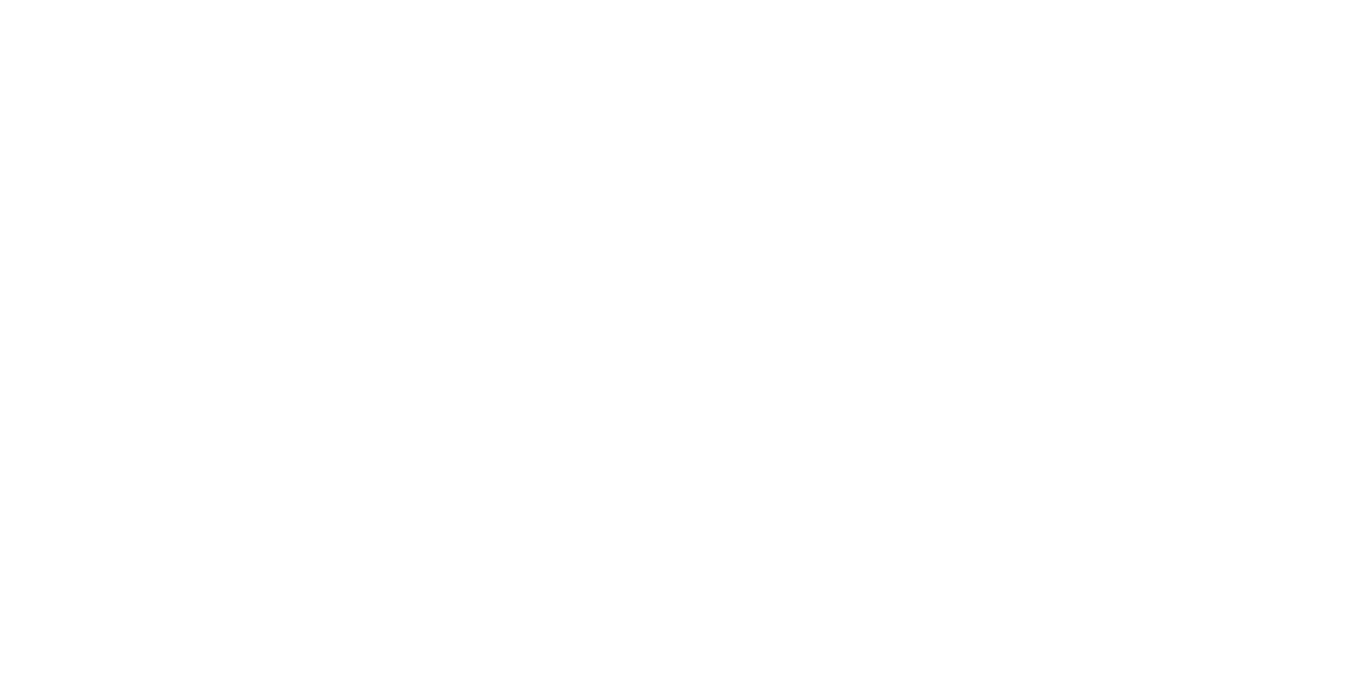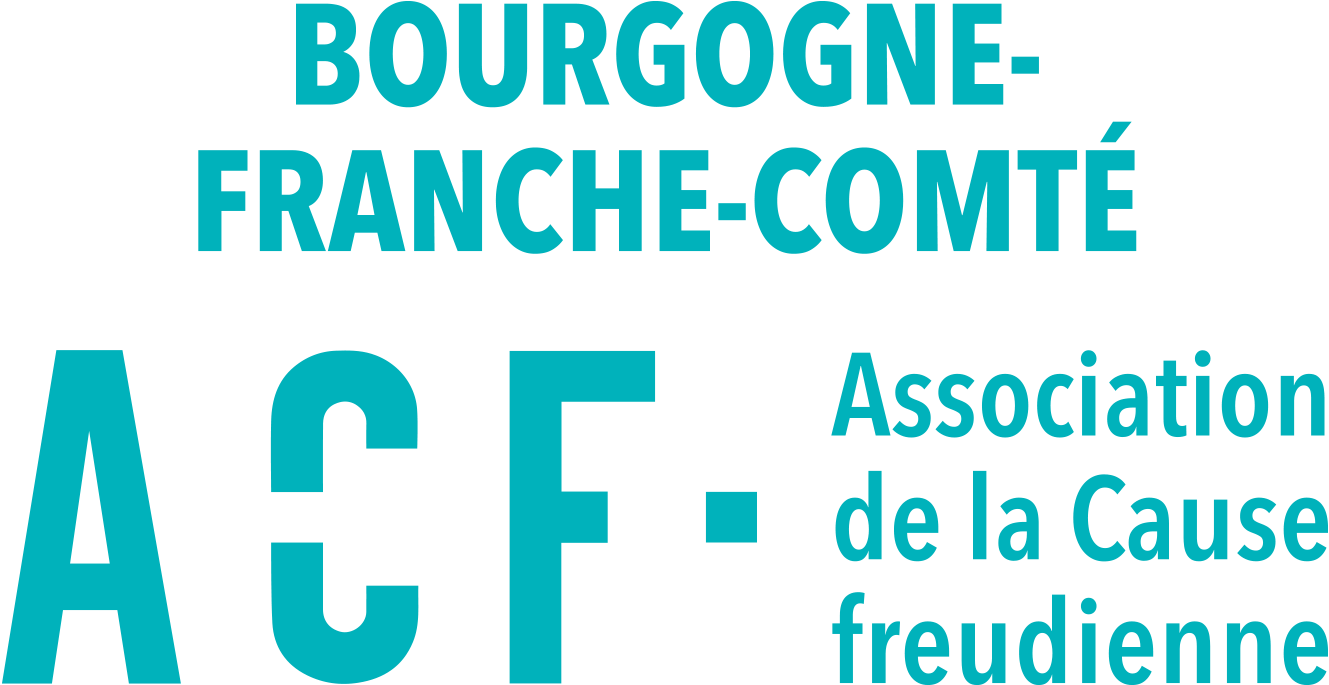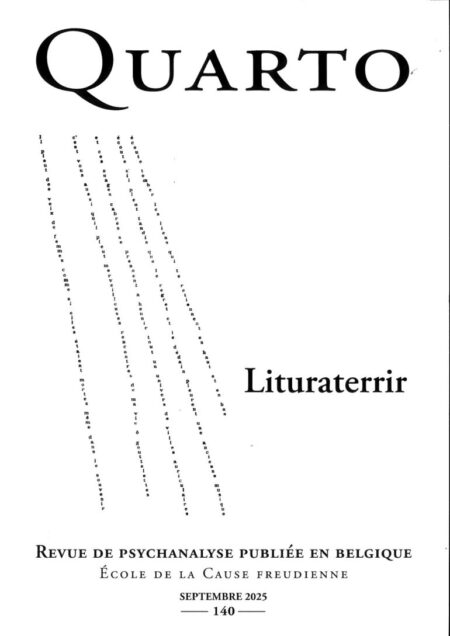Quarto n° 140
Editorial
Philippe Hellebois
Lituraterrir, qui donne le titre de ce numéro, a été forgé par Lacan dans son texte « Lituraterre » publié en 1971 [1]. Mot assurément nouveau à l’époque, un peu moins à la nôtre, il ne constitue pas pour autant un néologisme. Cancer verbal [2] selon Lacan, le néologisme détruit la langue tout comme le sujet qui l’énonce, puisque celui-ci se retrouve écrasé sous un trop grand poids de réel – c’est d’ailleurs la clinique des psychoses qui en constitue le champ électif. Lacan ne cherchait évidemment pas à détruire la langue, mais plutôt à la faire résonner au-delà du sens commun sagement rangé dans nos dictionnaires. La création langagière de Lacan est de l’ordre du mot d’esprit, du hapax, voire même tentative de franchir le mur du langage, note encore Jacques‑Alain Miller [3]. Lacan la portait alors à une puissance seconde, et du même mouvement propulsait la psychanalyse bien au-delà de la clinique pour toucher à la poésie et à la littérature. Il aura été ainsi l’un des grands écrivains de la langue française avant que celle-ci ne glisse sur une pente crépusculaire.
La littérature qui résonne dans ce titre est un peu bousculée parce qu’elle ne ressortit plus aux belles lettres. Loin du sublime et des miroitements du sens, la litura latine, qui s’entend d’abord, est proche de la rature et du déchet. La lettre selon Lacan n’est pas l’épure du mot, mais sa chute. Aussi latin soit-il, l’adage verba volant, scripta manent n’en est pas moins faux. En psychanalyse, certaines paroles restent, et ce sont les écrits qui s’envolent en achevant leur parcours dans la poubelle – c’est en ce sens que Lacan a pu dire « qu’une lettre arrive toujours à destination [4] ». Les premières, que Rabelais qualifie de gelées en un apologue célèbre par sa prescience de l’inconscient, peuvent ainsi nous tourmenter notre vie durant tant que l’analyse n’aura pu les transformer en feuilles d’automne. On trouvera d’ailleurs dans ce numéro un grand entretien sur Rabelais, auteur dont Lacan se sentait suffisamment proche pour lui reprendre son terme de sinthome, tout en se félicitant qu’il soit plus et mieux lu aujourd’hui qu’hier [5].
La lettre fait donc du signifiant un objet, lequel peut être vil, mais n’en a pas moins une chance de devenir plus réel. La lettre volée de Poe met la cour en émoi, et continue de faire couler beaucoup d’encre, et ceci sans que personne ne sache jamais le message qu’elle contenait. De la même façon, les lettres brûlées d’André Gide à Madeleine ont changé son destin alors que le texte en était irrémédiablement perdu. Pensons encore à Julien Sorel qui fait la conquête de la Maréchale de Fervaques en lui adressant des lettres écrites à une autre et qu’il n’a fait que recopier, etc.
La vraie littérature et la psychanalyse font donc tomber les mots de haut pour nous permettre d’en saisir le réel. On n’accède au réel qu’en tombant de son piédestal – ceci vaut autant pour l’amoureux que pour le psychanalyste. Lacan condensa tout ceci en une métaphore météorologique limpide, commentée dans le texte de J.‑A. Miller qui ouvre ce numéro : le signifiant, le sens, soit les semblants, sont nuées dans le ciel, et la pluie qui en tombe pour raviner le sol est lettre, laquelle enserre une jouissance dont on ne veut rien savoir – Apollinaire en a conçu un calligramme, Il pleut, qui fait notre couverture.
Ce numéro n’est pas consacré uniquement à la lettre, mais aussi aux publications qui sont les nôtres – L’Hebdo‑Blog, La Cause du désir,Ornicar ?, Mental, Studio Lacan –, et auxquelles la dernière journée de Question d’École a été consacrée. C’est l’occasion de vérifier qu’écrire n’est pas publier, ce serait même l’inverse, puisque publier revient peu ou prou à faire escabeau de ce dont il a fallu se séparer. Vous pourrez aussi mesurer l’effort de chaque revue pour ne pas tomber dans l’ornière qui guette toute publication, celle de se transformer en poubelle, puisque chaque lettre est proche du déchet – Lacan en a forgé un autre mot nouveau, celui de poubellication [1].
L’impertinence propre au bon lecteur l’amènera à poser la question de savoir pourquoi une pratique de bavardage comme la nôtre accorde une telle importance à la lettre. La réponse de Lacan est de considérer que nous écrivons même en parlant à l’instar de l’analysant dont le travail consiste à cerner le réel qui le fonde.
Lituraterrir fait encore résonner la dimension de l’atterrissage indispensable à la psychanalyse. Les analystes n’ont effectivement pas d’autre choix que de faire la théorie de leur pratique, mais toujours dans l’après-coup – jamais avant. Et en quoi consiste le contrôle sinon en un effort d’écrire ce qui s’est passé, seule façon d’échanger les semblants qui font notre ordinaire pour une touche de certitude ?
Le lecteur trouvera encore dans ce numéro un dossier consacré à ceux qui sont forcés de vivre avec les divers diagnostics dys – de la dyslexie à l’autisme sous le label poétique de troubles neurodéveloppementaux, autant d’évadés plus ou moins volontaires de la prison psychologique construite par le discours du maître moderne.
En cette période marquée par la publication récente du Séminaire de Lacan sur L’Acte psychanalytique [2], ce numéro ménage aussi la place qui convient aux travaux consacrés à sa lecture.
[1]. Lacan J., Le Séminaire, livre xiii, « L’objet de la psychanalyse », leçon du 15 décembre 1965, inédit.
[2]. Lacan J., Le Séminaire, livre xv, L’Acte psychanalytique, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil & Champ freudien Éd., 2024.
[1]. Lacan J., « Lituraterre », Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 11-20, « lituraterrir » se trouve à la page 18.
[2]. Cf. Lacan J., « Propos sur la causalité psychique », Écrits, Paris, Seuil, 1966, p. 167.
[3]. Miller J.-A., « Le mot juste », Cahiers de l’Unebévue, no 49, hiver 2003-2004, p. 57.
[4]. Lacan J., « Le séminaire sur “La Lettre volée” », Écrits, op. cit., p. 41.
[5]. Cf. Lacan J., « Lituraterre », Autres écrits, op. cit., p. 12.
[7]. Lacan J., Le Séminaire, livre xiii, « L’objet de la psychanalyse », leçon du 15 décembre 1965, inédit.
[8]. Lacan J., Le Séminaire, livre xv, L’Acte psychanalytique, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil & Champ freudien Éd., 2024.
Sommaire
Éditorial
Philippe Hellebois
L’orientation lacanienne
Jacques-Alain Miller, L’or à gueule de la lituraterre
Lettres et publications
Anaëlle Lebovits-Quenehen, Introduction à Question d’École
Gil Caroz, Studio Lacan : lire les traces d’une rencontre
Hervé Castanet, « On publie quelque part »
Alice Delarue, Psychanalyse appliquée et subjectivité de l’époque
Deborah Gutermann-Jacquet, Ornicar ?, un éclectisme orienté
France Jaigu, La revue fait École
Philippe Hellebois, Quarto, revue hérétique
Clinique
Carole Dewambrechies-La Sagna, Le môtre ?
Anne Semaille, Écriture d’un désastre
Entretien
Romain Menini, Rabelais à la lettre
Du côté des dys
Ligia Gorini, Dystopie du savoir
Philippe La Sagna, Les Dys ou les évadés de la lecture
Jean-Claude Maleval, L’expansion des faux autistes
Sébastien Ponnou, TND versus clinique du sujet
Éric Laurent, Commentaire
Daniel Roy, Le sommeil de la raison
Angèle Terrier, L’empire du diagnostic
Éric Laurent, Commentaire
Études
Sophie Charles, Autour de l’écriture poétique chinoise
Geert Hoornaert, Hamlet ou la vie selon le signifiant
Nathalie Jaudel, La féminisation du monde et son refus
Gustavo Freda, Jean Carbonnier, la famille Gide et Jacques Lacan
Alfredo Zenoni, Le réel de la condition humaine
Lectures du Séminaire L’Acte psychanalytique
Ginette Michaux, « Le savoir fait faille »
Jean-Claude Encalado, Le corps chez Descartes
Éric Zuliani, « L’ombilic de l’acte manqué »
Thèse
Aurélie Flore Pascal, Beauvoir amoureuse
Couverture
Yves Depelsenaire, Apollinaire, « Il pleut »
Prix : 17,06 euros