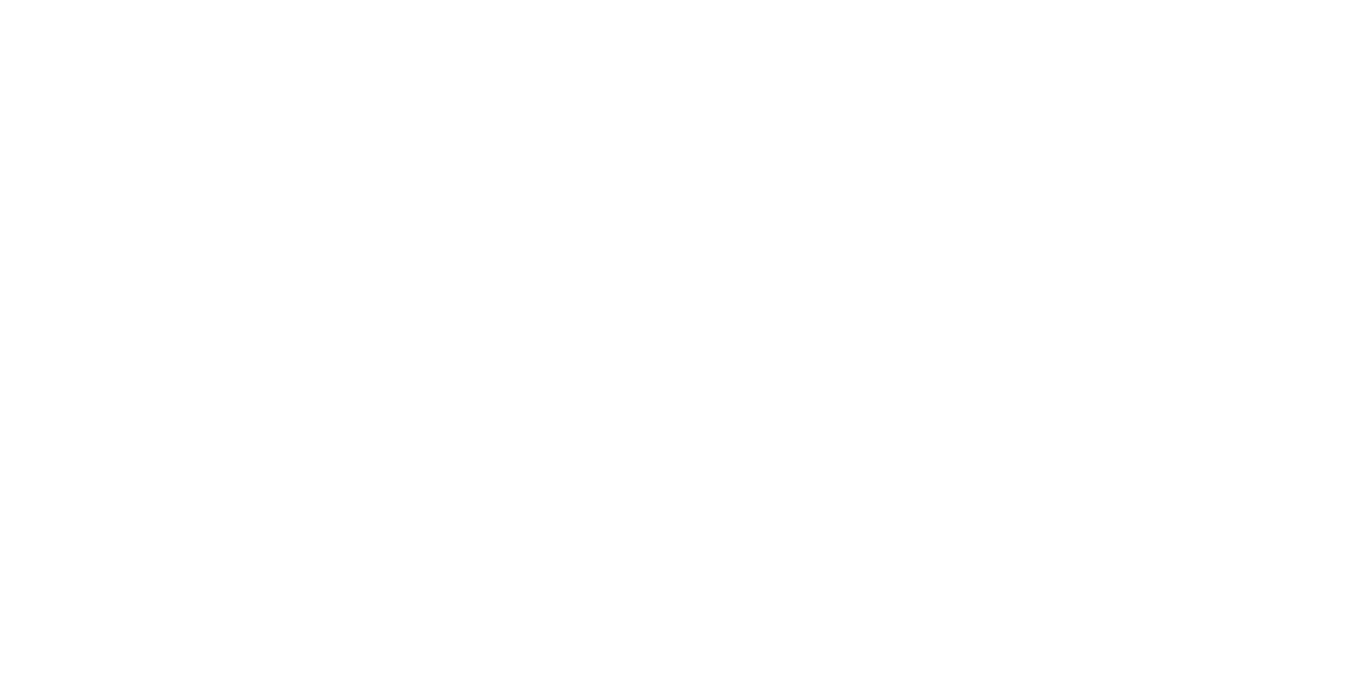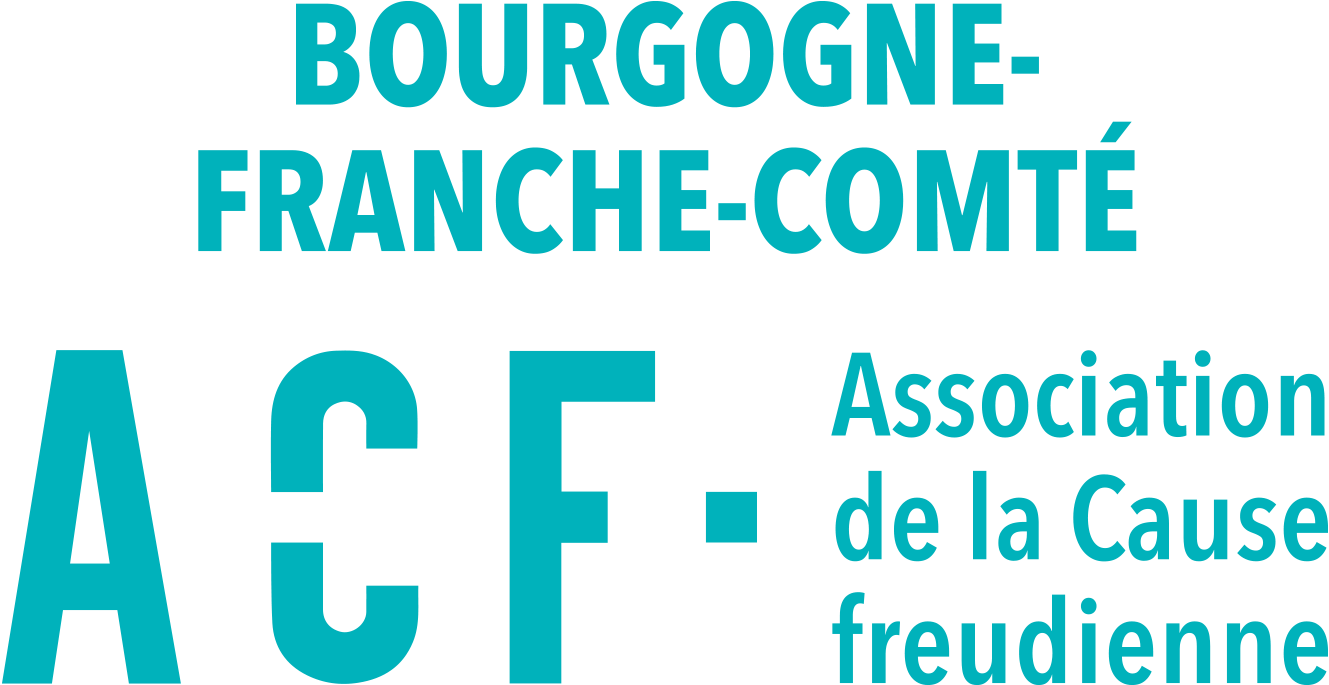Editorial
L’envers de l’image
Partant d’une intuition clinique de Melanie Klein [mfn]Cf. Klein M., « Notes sur quelques mécanismes schizoïdes », Essais de psychanalyse, Paris, Payot, 1968, p. 68-89. [/mfn], Lacan fait du corps morcelé la condition primitive du corps du sujet, antérieure à toute unité imaginaire [mfn] Cf. Lacan J., « Le stade du miroir comme formateur de la fonction du Je telle qu’elle nous est révélée dans l’expérience psychanalytique », Écrits, Paris, Seuil, 1966, p. 97.[/mfn]. Le morcellement est le contrechamp de la forme unifiée du corps : il apparaît dans les rêves et fantasmes, se lit dans le découpage des symptômes hystériques, se décèle en creux dans les fortifications à la Vauban de l’obsessionnel, surgit à ciel ouvert dans la schizophrénie. Si la théorie kleinienne le lie à l’action des pulsions archaïques, il est, pour Lacan, l’effet du signifiant qui introduit une perte, dont les objets pulsionnels sont autant de restes [mfn]Cf. Lacan J., « De la psychanalyse dans ses rapports avec la réalité », Scilicet, no 1, mars 1968, p. 4. [/mfn].
Le corps est comparable à un « amas de pièces détachées [mfn]Miller J.-A., « Pièces détachées », La Cause freudienne, no 60, juin 2005, p. 158. [/mfn] », dont certaines sont élevées à la dignité du signifiant – le phallus en étant l’exemple le plus éminent. Jacques-Alain Miller souligne qu’à côté de cette signifiantisation du corps, la fin de l’enseignement de Lacan met l’accent sur la corporisation du signifiant, qui produit des effets d’affect et de jouissance, découpant le corps de l’être parlant [mfn] Cf. Miller J.-A., « Biologie lacanienne et événement de corps », La Cause freudienne, no 44, février 2000, p. 57.[/mfn]. Cette corporisation, ajoute-t-il, est susceptible d’illustrations anthropologiques, comme les marques et mutilations rituelles, tandis qu’à l’heure du déclin des traditions, la corporisation contemporaine est plutôt le siège d’inventions originales et multiples, « qui tendent à répondre à la question “que faire de son corps ?” [mfn]Ibid., p. 58. [/mfn] »
Si l’on se situe au niveau des discours, il est évident que les signifiants fragmentent le corps de manière différente selon les moments de la civilisation. L’anthropologue David Le Breton, dont vous lirez l’entretien dans ce numéro de Mental, souligne que dans la tradition chrétienne, l’idée du dualisme entre l’âme et le corps était néanmoins doublée d’une indivision, ce qui maintenait un interdit majeur sur l’ouverture des corps – jusqu’à ce que quelque chose se modifie suffisamment dans les discours pour que les premiers anatomistes s’autorisent à passer outre. La science, parce qu’elle ne s’arrête pas à l’image de la belle forme du corps, ou à sa prise dans le signifiant, ouvre à la possibilité d’opérer sur le réel de l’organisme [mfn]Cf. ibid., p. 11.[/mfn].
Depuis, les progrès de la médecine scientifique font exister un corps toujours plus quantifiable, mesurable, un corps percé à jour par l’imagerie, segmenté par l’hyperspécialisation, réparé voire augmenté par les prothèses. Mais, derrière ce corps objectivé – qui correspond à ce que Descartes conceptualisait comme l’étendue [mfn]Lacan J., « Psychanalyse et médecine », Lettres de l’École freudienne de Paris, no 1, 1967, p. 42. [/mfn] –, persiste le corps subjectivé, dont le morcellement par le signifiant et la jouissance est pour chacun toujours singulier. L’entretien avec le chirurgien Hugues Pascal-Moussellard nous montre comment le médecin doit savoir faire avec les paradoxes qui se situent entre ces deux corps, en invitant, par exemple, le patient à nommer sa souffrance et sa demande avec ses propres mots, là où beaucoup tendent à se ranger sous des diagnostics figés.
Le discours de la science a introduit dans notre monde des progrès techniques et d’innombrables gadgets qui se branchent sur les organes, notamment perceptifs. La civilisation promet une augmentation du corps mais, comme l’indique Éric Laurent, cette amplification devient elle aussi « un mode de morcellement lorsque l’organe supplémentaire fait défaut ou lorsque le corps vient à manquer à la machine, empêché ou bloqué par des embarras [mfn] Laurent É., « Le corps morcelé par ses organes », dans ce numéro de Mental, p. 11. [/mfn] ». Alors, l’angoisse ne manque pas de surgir, signant que le corps humain échouera toujours à faire couple avec la machine.
« Le corps des parlants est sujet à se diviser de ses organes, assez pour avoir à leur trouver fonction [mfn]Lacan J., « L’étourdit », Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 456.[/mfn] », énonce Lacan dans « L’étourdit ». Quand on se situe au niveau du corps vrai, affecté par le langage, la fonction des organes peut en effet se perdre « dans un excès d’émois [mfn]Laurent É., « Le corps morcelé par ses organes », op. cit., p. 16. [/mfn] ». Ce numéro explore ainsi une clinique très actuelle : corps débordés par l’agitation ou désertés par le désir, corps fatigués ou mis à l’épreuve dans le sport extrême, corps exhibés, corps addicts… Ces symptômes ne peuvent être lus ni traités qu’à la lumière de la jouissance, corrélative du criblage [mfn] Cf. Lacan J., « Le phénomène lacanien », Essaim, no 35, 2015, p. 153. [/mfn] du corps par le signifiant. L’enjeu d’une analyse est dès lors que le sujet puisse s’en faire responsable, sans chercher à en recoller tous les morceaux.
Alice Delarue
Sommaire
Éditorial
L’envers de l’image – Alice Delarue
Effets des discours
Le corps morcelé par ses organes – Éric Laurent
Partenaire de notre temps – Jean-Pierre Deffieux
Corps versus machine – Hervé Castanet
La machine dérangée – Quentin Dumoulin
Entretien avec David Le Breton
Explorer le corps
Corps agités, corps désertés
Tout le monde est fatigué – Dalila Arpin
L’extrême dans le sport – Mauricio Diament
Rompre avec le corps – Jean-Marc Josson
L’éveil – De l’excès à la duperie – Andrea Orabona
J’appartiens à mon corps – Sarah Abitbol
Nouveaux symptômes dans les services de médecine – Sarah Camous-Marquis
Dénouages
Mobiliser le vivant – Anne Colombel-Plouzennec
Transfert d’appareil – Ariane Fournier
Pour une clinique du corps qui échappe – Carlo De Panfilis
Êtres de parole dans des corps cabossés – Élise Etchamendy
Entretien avec Hugues Pascal-Moussellard
Un superbe geste
Faire oeuvre du corps
Le corps et l’écriture dans le dernier Pasolini – Claudia González
Le corps qui fait – Esperanza Molleda
Impossible d’escaboter – Guy Briole
Corps analysants
Être averti de sa méconnaissance – Neus Carbonell
La véritable cause de la réalité psychique – Dossia Avdelidi
Cas cliniques
Les deux corps de Monsieur N. – Philippe Hellebois
La livre de chair – Marina Frangiadaki
Du No sé au No-Sí – Rocío Cid
Lectures
Le sublime et la guenille – Nelson Hellmanzik
L’imprévisible – Gustavo Freda
La pauvre créature de la science fait sa révolution – Carole Niquet
De la double vie à la seconde mort – Serena Guttadauro-Landriscini
Étrangèreté – Isabelle Orrado
Se désincarner : de végétarienne à végétal – Carla Antonucci
Un reste à dire – Olivia Bellanco
Auteur
Collectif
Rédacteur
Alice Delarue
Éditeur
Eurofédération de psychanalyse (EFP)
Année
2025
Pages
208 pages
Prix
19 €